Ce n’est pas ce Roma Eterna que je cherchais à l’origine, mais Le Nez de Cléopâtre, un recueil d’uchronies rassemblées sous l’égide de Robert Silverberg. Comme je ne suis pas parvenu à le trouver, sans doute parce qu’il n’existe qu’en version française, je me suis rabattu sur ce gros bouquin dont l’auteur et le principe sont les mêmes.
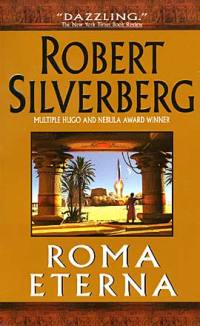
Eos :: 1989/2003 :: acheter ce livre
L’Empire Romain n’a jamais sombré. Infaillible, protégé des Dieux, il est venu à bout de tous les périls et à perduré jusqu’à nos jours. Voici l’histoire relatée par Robert Silverberg à travers une série de nouvelles qui prennent place entre 450 à 1970 après JC. Pardon, entre 1203 à 2723 selon le calendrier romain, toujours en vigueur dans ce monde alternatif. Le long de cette dizaine de petites histoires, Silverberg nous présente, via le regard de tel ou tel témoin privilégié, l’évolution de l’invincible Empire à travers les époques. Ce genre d’exercice s’appelle une uchronie, et il y a deux façons de les apprécier : soit par la vision de l’Histoire dévoilée par l’auteur, soit par la force des fantasmes qu’il met en scène dans ses pages.
Côté philosophie de l’Histoire, rien de bien original. Robert Silverberg a bâti son roman sur une thèse célèbre : celle développée par Gibbon au XVIIIème siècle et selon laquelle le Christianisme aurait causé la perte de Rome en détournant les ressources de l’Empire de l’Etat vers l’Eglise. L’auteur imagine que l’Exode des Hébreux en Egypte aurait été un échec, qu’il n’y aurait jamais eu de Royaume de David et de Salomon, et donc pas de Christ non plus, que jamais l’Empire ne se serait converti à une religion monothéiste et que, partant, il aurait triomphé des barbares et de la décadence. Ceci est une théorie terriblement datée, qui surestime le poids du Christianisme des origines sur la culture romaine, alors que l’influence inverse fut sans doute largement aussi importante. Mais soit, continuons. Ce point de départ accepté, voyons comment Silverberg imagine un monde sous l’égide permanente de Rome.
L’Histoire qu’il nous décrit est en grande partie une Histoire à papa, un lieu où de grands hommes ont le pouvoir de changer le monde. Supprimez Mahomet brutalement de la scène ("A Hero of the Empire"), et jamais les guerriers de l’Islam ne s’empareront de la rive sud de la Méditerranée. Mettez un grand capitaine à la tête de l’Empire ("With Caesar in the Underworld") et les barbares seront repoussés pour toujours. En bon Américain, Silverberg semble considérer que seuls deux facteurs sont à même de faire changer une société : la volonté des hommes exceptionnels et les périls extérieurs. Pour autant, il ne nie pas tout à fait l’existence de tendances lourdes : un consul a beau tenter de préserver l’intégrité de l’Empire par la terreur ("The Reign of Terror"), il ne fait que retarder les transformations nécessaires ; et le personnage principal de "Getting to Know the Dragon" admet qu’il y a plus à apprendre sur l’Histoire en épluchant des rapports comptables qu’en s’attardant sur les exploits des gens célèbres. Mais ces tendances lourdes, Silverberg les met peu en valeur.
Cette vision archaïque de l’histoire pourrait passer si l’auteur se rattrapait par une imagination débridée. Mais dans ce domaine aussi, le roman se montre pauvre. L’Histoire que Silverberg prétend inventer n’est en fait que la nôtre. Avec Roma Eterna, on a l’impression d’assister à une partie de géante de Civilization. Les maîtres et les peuples peuvent changer, mais il n’y a, grosso modo, qu’une seule voie possible vers le progrès, avec en ligne de mire la colonisation de l’espace. Après l’Antiquité, le Monde connaît le Moyen-Âge, la Renaissance et la Révolution. Les Italiens finissent par parler Italien (pardon, Romain). Des nations française, britannique, espagnole, portugaise, allemande (pardon, gauloise, bretonne, hispanique, lusitanienne, teutonne) apparaissent et s’affirment. Des doges gouvernent à Venise. Et les Viennois dansent la valse en 1900. Les seuls moments de divergence totale avec notre Histoire sont l’épisode de la conquête de l’Amérique ("The Second Wave") où des légions romaines se heurtent aux Mayas, ainsi que la toute dernière nouvelle du livre ("To the Promised Land"), celle où les Hébreux, après trois millénaires passés à ronger patiemment leur frein, tentent un nouvel exode.
Pour le reste, la seule véritable différence avec notre Histoire, c’est Rome. Une Rome vraiment éternelle, sous cloche, avec ses consuls, ses patriciens, ses légionnaires et ses gladiateurs. Une Rome de péplum, avec des figures récurrentes et peu originales, celle du serviteur dévoué ("Waiting for the End"), du général exemplaire ("The Second Wave"), de l’héritier débauché qui se révèlera un grand chef ("With Caesar in the Underworld", "Waiting for the End"), de l’empereur mégalomane ("The Second Wave", "Getting to Know the Dragon"). Sans oublier les séances d’orgie ("With Caesar in the Underworld", "Via Roma"), passage obligé du folklore romain.
Présenté comme cela, Roma Eterna pourrait paraître décevant. Mais c’est oublier un troisième critère d’appréciation : le talent de conteur de Silverberg. Les nouvelles de l’auteur, son style narratif et ses intrigues sont tout ce qu’il y a de plus classique. Pourtant ça tourne, ça roule, c’est extrêmement bien huilé et bien articulé. Tout ce que contient ce livre est prévisible et attendu. Mais cela ne gâche en rien le plaisir de lecture.

Fil des commentaires
Adresse de rétrolien : https://balzac.fakeforreal.net/index.php/trackback/590