Le grand troupeau est la contribution de Jean Giono à la littérature dense qui, entre les deux conflits mondiaux, se consacra au premier d'entre eux. Et sans surprise, ce livre est un réquisitoire contre la guerre. Il s'attache à en décrire les horreurs, et à en dénoncer l'absurdité. Il nous dépeint avec des détails crus, et dans le style rapide caractéristique de l'auteur provençal, les abominations du front. Ses scènes sont riches en morts, en feu, en sang et en acier. Elles nous parlent de membres arrachées, de viscères coulant des ventres et de cervelles épandues sur le sol boueux des tranchées. Elle met en scène des soldats, bringuebalés n'importe où, emportés par la peur et la folie. Mais cela n'est pas tout.
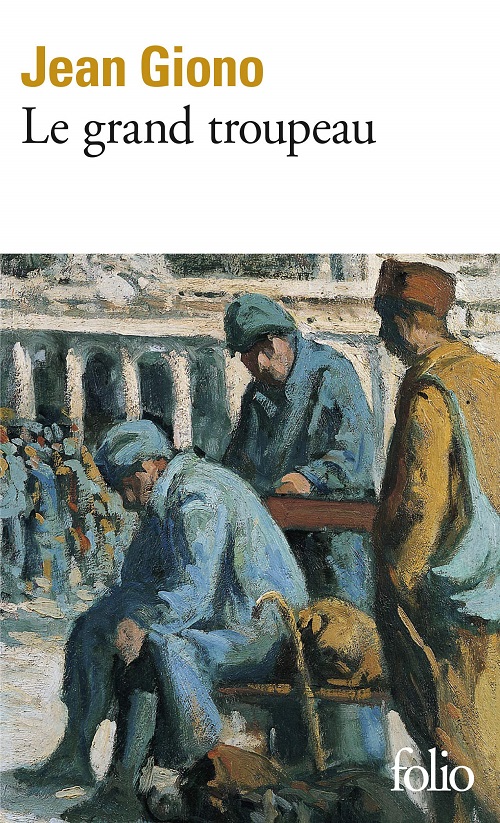
L'intérêt de ce Grand Troupeau, c'est aussi de nous parler de l'arrière. Ce livre, en effet, nous rappelle que le drame de la guerre se jouait aussi en retrait des zones de combats. Nous relatant la destinée d'une famille de paysans provençaux (le père, le fils, la bru, la fille, l'ami de cette dernière, et quelques autres), le récit bascule sans cesse de leur ferme au front.
En plus des violences du combat, le livre fait part des angoisses de ceux dont les proches sont allés à la guerre, des travaux pénibles auxquels doivent s'atteler maintenant les vieux et les femmes, de la misère sexuelle de ces dernières, privées d'hommes pour de longs mois, de la mise à l'épreuve de leur fidélité, de leurs enfants non désirés. Et puis, plus tard, du retour délicat de leurs amants et conjoints, changés pour toujours par l'épreuve du feu et par les mutilations.
Ce roman nous relate un drame. Il nous montre des couples fauchés et une jeunesse détruite par la guerre. Cependant, il finit sur une note positive, nous racontant, au sein d'une famille éprouvée mais retrouvée, la naissance d'un enfant en bonne santé, et donc la victoire de la vie. Cette fin heureuse, et plus précisément ce moment où un berger vient bénir le nouveau-né, c'est aussi celui de la morale de l'histoire :
"Bélier, viens-ici. Souffle sur ce petit homme pour qu'il soit, comme toi, un qui mène, un qui va devant, non pas un qui suit" (p. 251).
C'est ici le seul moment du roman où il est question du libre-arbitre, du contrôle de son destin, du triomphe de la volonté individuelle, la réponse de Giono à la guerre. Partout ailleurs, à l'inverse, il fait le portrait de suiveurs, il nous parle d'un malheur subi. Il nous montre des soldats dociles, dépassés par les événements, envoyés les uns après les autres à l'abattoir, dans la résignation. Bref, d'un grand troupeau.
Afin que le parallèle avec l'animal soit plus évident encore, il commence d'ailleurs son récit en nous relatant une transhumance absurde et meurtrière, prenant en place en Provence dans la chaleur de l'été 14, concomitante à la mobilisation des hommes, dont elle est évidemment la métaphore.
Les hommes, dans la guerre, sont ravalés au rang de bêtes. Ils ne vivent toujours que dans l'immédiat, et dans la crainte du prochain instant. Dans Le grand troupeau, on ne questionne pas les buts de guerre, on ne réfléchit pas sur les tenants et les aboutissants du conflit, ou sur son bien-fondé moral. La passion l'emporte sur la raison. Les actions s'enchainent, mais aucun plan de bataille ne nous est présenté. Seuls subsistent le récit d'attaques et de contre-attaques anarchiques et aléatoires, et des soldats dépassés qui n'attendent qu'une chose : que cela cesse. Sans pourtant en avoir le pouvoir ou l'initiative, animaux qu'ils sont, plutôt qu'hommes, menés sans broncher vers la grande boucherie.

Fil des commentaires