Il y a deux manières de lire aujourd'hui Les demi-vierges de Marcel Prévost, un roman qui, en son temps, fût un succès de librairie. La première façon, c'est de le faire au premier degré et de s'offusquer, comme semble le faire son auteur, sur le comportement qu'il mettait ici en scène : celui de jeunes filles de bonne famille qui, en attendant de trouver l'époux qui leur apporterait une vie d'aisance, satisfaisaient les appétits sexuels de leur jeunesse par des flirts ainsi, on le devine, que par des attouchements qui évitaient de mettre en péril l'intégrité de leur hymen.
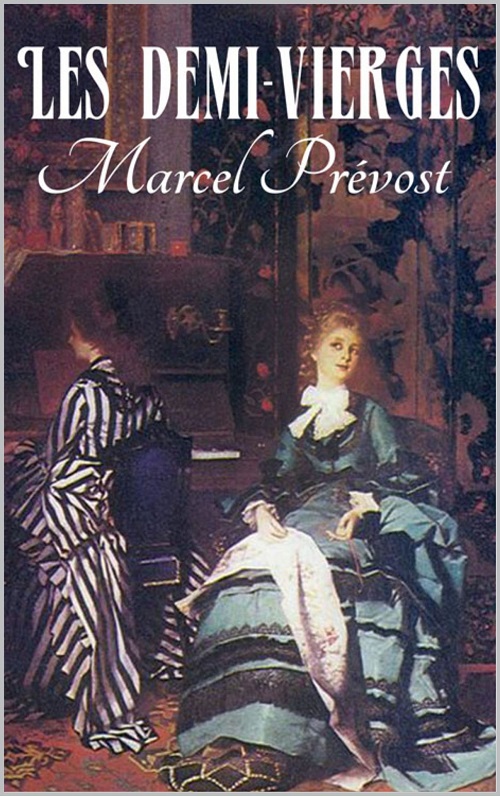
On peut, comme Maxime de Chantel, ce brave noble de province qui s'éprend de la principale demi-vierge mise en scène dans ce livre, Maud de Rouvre, se montrer terrifié par la perversité d'un Paris dépravé et corrupteur, où les mondanités peuvent à l'occasion dégénérer en bacchanales. On peut, si l'on est prude et encore attaché à la morale bourgeoise de la fin du XIXème siècle, dénoncer la dégradation des mœurs, déplorer le désordre des sens.
On peut, comme l'auteur, un homme qui a fait ses débuts dans un journal monarchiste et conservateur, se montrer sexiste, et faire moins de cas de la virginité des hommes que de celle des femmes ; anglophobe, en notant que la pratique du flirt, comme le mot lui-même, vient d'Angleterre, tout comme cette Maud qui y a vécu et porte un prénom anglais ; voire, comme tant d'autres à l'époque, exhaler quelques relents d'antisémitisme, quand Maud, repoussée par Maxime de Chantel, n'a plus qu'à jeter son dévolu sur un Juif fortuné, et peu regardant sur la pureté de sa proie potentielle. On peut, en somme, déplorer un monde où tout fout le camp, où les sentiments cèdent aux calculs.
Du drame ? Est-ce qu'on en voit dans le monde, aujourd'hui ? Il n'y a plus de passions, il n'y a que des appétits. Il n'y a plus de jalousies, il n'y a que des dépits.
Mais il y a une autre façon de lire ce récit : celle qui nous fait percevoir la réalité, cruelle, de la société bourgeoise de la Belle Epoque, un monde où les femmes sont livrées à elles-mêmes, sans autre moyen de réussir leurs vies que de se lancer dans une course effrénée au meilleur mariage, sans autre arme que leur beauté, et dont la seule garantie d'indépendance, un travail salarié, est perçu comme un déclassement, comme une ultime humiliation.
Il y a deux façons de percevoir cette Maud de Rouvre qui instrumentalise son soupirant, Maxime, tout autant que son amant, Julien de Suberceaux. On peut la voir comme une calculatrice, comme une perverse, trompeuse, machiavélique et froide ; ou bien comme la première femme moderne, tentant de concilier plaisir et sécurité dans un monde qui ne peut lui accorder les deux à la fois ; comme un esprit fort qui refuse de devenir une femme-objet.
Car si Les demi-vierges a autant passionné les lecteurs d'alors, ce n'est sans doute pas seulement parce que ce livre traitait de perversités marginales, confinées au microcosme parisien. Mais au contraire parce qu'il annonçait, en mettant en scène les luttes et les flirts de ces femmes émancipées, les évolutions à venir, le monde d'après.
Si toutes les jeunes filles pensaient comme moi, mon cher, nous ferions notre petit 89, et nous gagnerions nos libertés de vive lutte (…). Liberté de sortir et de voyager seule, d'abord. Liberté de rentrer chez nous à l'heure qu'il nous plaît, de ne rentrer que le matin, par exemple. Vous n'imaginez pas ce que cela m'amuserait de noctambuler. Liberté de dépenser de l'argent à notre fantaisie, liberté d'avoir des amants… Oui, des amants… Vous avez bien des maîtresses.

Fil des commentaires
Adresse de rétrolien : https://balzac.fakeforreal.net/index.php/trackback/1915