Il a intérêt à être bien. Voilà ce qu'on se dit quand on s'attaque à un tel pavé. Il vaudrait mieux que ces 1300 pages en valent la peine puisque, compte-tenu de notre rythme de lecture, elles occuperont à coup sûr quelques semaines de notre vie, voire plusieurs mois. Ceux qui s'y étaient lancés les premiers, cependant, n'avaient pas toujours été très encourageants. Ils avaient signalé que ce livre démarrait à la façon d'un diésel et que l'action ne survenait que tard, trop tard dans l'histoire. Ce qui, au fond, était prévisible. C'est toujours ainsi que Brandon Sanderson organise ses récits. Avec un systématisme industriel, ses romans adoptent la forme classique d'un crescendo, lui-même organisé, à travers ses grandes parties, en une succession de crescendos.
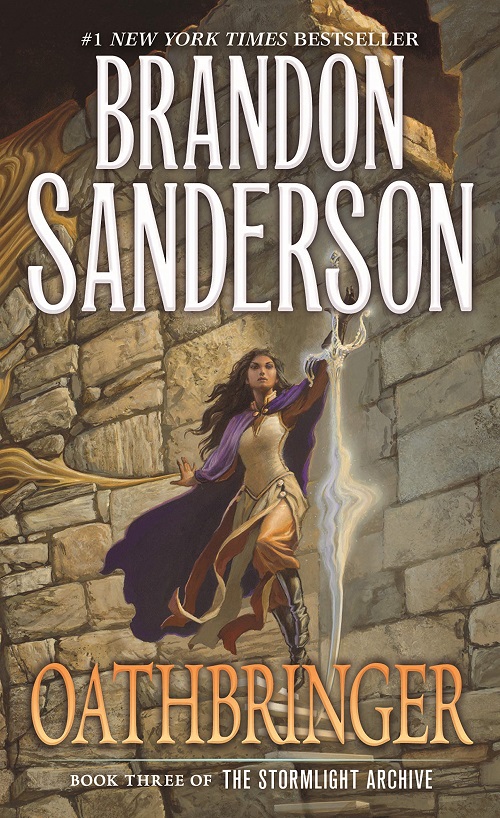
Le grand principe de ces sagas fleuves de fantasy, comme ici The Stormlight Archive, c'est d'étirer l'action. C'est de démultiplier les protagonistes. C'est de dédoubler les intrigues principales par des flashbacks, et par la perspective complémentaire, entre les chapitres principaux, de personnages très secondaires. C'est de densifier la narration afin de prolonger au possible, pour le lecteur, l'expérience immersive et échappatoire. C'est de l'emmener pour très longtemps dans un autre monde d'autant plus prenant que, tout fictif et fantasmatique soit-il, il est construit avec la précision et avec la rationalité d'une horloge. On reconnait les grosses ficelles, et quelquefois, Sanderson s'emmêle dedans, notamment quand il se lance dans de longs dialogues creux qui feraient passer ses personnages, a priori de grands héros, en toute logique les lumières de leur monde et de leur temps, pour de parfaits abrutis.
Par exemple, dans ce moment important où le personnage principal, Dalinar, reçoit la traduction d'une vieille archive révélant la nature originelle des voidbringers, les grands méchants qui de tout temps menacent son monde, le texte de ce document aurait suffi, il laissait peu de doute sur l'identité des monstres en question. Mais non, il a fallu que l'on assiste au monologue intérieur de l'intéressé qui, après quelques secondes de confusion, réalise que "ah mais oui, en fait les voidbringers c'est….". Ça va, à moins qu'il soit totalement idiot, le lecteur avait compris... Mais afin de prolonger sa narration, il faut toujours à Brandon Sanderson qu'il décrive par le détail toutes les circonvolutions des pensées, parfois plutôt triviales, de tous ses personnages.
Mais cela est un défaut mineur, l'un de ceux qu'on pardonne à Sanderson. Car dans ses premières pages (ou plus exactement dans ses premières centaines de pages), contrairement aux retours trompeurs partagés par certains, Oathbringer est bien. Il est même très bien. Avec ce troisième tome, on arrive enfin au moment où, dans toute bonne saga de fantasy, on en découvre un peu plus sur le monde, sur ses peuples, sur leurs us et coutumes, et sur les secrets de son passé. Et cette capacité à construire et à raconter un monde, cette qualité de wordbuilder, on sait bien que c'est la grande qualité de Sanderson, ce à quoi il excelle. Par ailleurs, en ce qui concerne l'action, ce n'est pas si chiche que cela, si l'on mentionne la virée de Kaladin chez ses ennemis parshmen, la confrontation de Shallan avec un Unmade, le siège de Kholinar et la virée de plusieurs héros dans le monde parallèle de Shadesmar.
Le seul autre défaut de Sanderson, dans ces premières parties plus lentes et politiques, c'est son impuissance à penser l'homme médiéval. Ou plutôt son renoncement à le faire. The Stormlight Archive, certes, c'est de la fantasy, mais ce n'est pas du médiéval-fantastique. Ce sont des gens au mode de pensée contemporain, précipités dans un monde alternatif. Le cycle, en effet, regorge de notions bien modernes. On parle de technologie, et même de psychanalyse. Le monde est cartographié et délimité, il n'est pas un inconnu sans limite et plein de mystères. On dirait même qu'Urithiru, la nouvelle capitale de l'alliance menée par Dalinar, c'est le siège de l'ONU. Grâce à la technologie locale (ou la magie, qu'importe ce qu'elle est vraiment), on s'y déplace plus aisément qu'en avion, on s'envoie des fax à longueur de journée, on débat géopolitique devant une mappemonde et on s'engueule gaiement.
Mais tout cela n'est pas spécifique à Sanderson, c'est vrai d'une grande partie de la fantasy. Ce qui est plus gênant avec ce livre, cependant, c'est sa fin. Certains, trop heureux de voir le récit s'emballer enfin, en ont vanté le rythme effréné. Il s'agit en effet d'une longue bataille démesurée décrite sur des dizaines et des dizaines de pages, qui multiplie à toute allure les vues subjectives, dans le style de celle qui survient à la fin de Winter’s Heart, dans La Roue du Temps. Mais si celle-ci était menée de main de maître par un Robert Jordan, le grand modèle de Sanderson, au sommet de sa forme, dans le cas de Oathbringer, on dirait plutôt le dénouement d'un mauvais Avengers.
Voilà soudain lors de la confrontation finale, alors que tout semblait perdu, que surgissent autour de Dalinar tous les héros scintillants avec leurs pouvoirs extraordinaires, pendant qu'en face l'ennemi déploie une inquiétante armada bigarrée. Pour un peu, on s'attendrait presque à voir débarquer Hulk et Thanos. Et à partir de ce instant, ça devient proprement stupide. Odium, qu'on nous présente comme un dieu dont l'intelligence dépasse l'entendement, voit son plan diabolique tomber piteusement à l'eau. Alors qu'ailleurs dans le récit, le moindre changement psychologique s'opère à travers des pages et des pages, tout ici se déroule soudainement de façon brouillonne et précipitée.
L'assassin qui a tué le frère de Dalinar (et qui a tenté d'en faire autant avec lui), en plus d'être plus ou moins à l'origine de la panade où le monde de Roshar se trouve aujourd'hui, rejoint soudainement le camp des gentils, sans que cela fasse grand pli. Ah, tiens il est avec nous lui maintenant ? Soit. Navani, qui s'inquiète pendant tout le livre du sort de son fils, s'en remet finalement très bien quand elle apprend ce qu'il est advenu de lui. Elle tombe un instant dans les bras du porteur de la sinistre nouvelle, mais pour le reste il n'y paraît plus. Fin de l'histoire. Et quand enfin, on arrive à ce tournant du livre où un traitre est identifié parmi les personnages principaux du roman, alors qu'on s'apprête à vivre avec cette découverte un grand moment d'intensité dramatique, le félon s'avère finalement être un héros brave et intrépide.
Tout ça pour ça. Toutes ces pages, tout ce monde finement décrit et mis en scène, tout cet enchevêtrement d'intrigues et d'arcs narratifs, pour ce dénouement décevant et déconcertant, à la fois très prévisible et mal ficelé.
That a thing is hated is not proof that it's great art, but the lack of hatred is certainly proof that it is not (p. 1293)
Qu'une chose soit détestée ne prouve pas qu'il s'agisse de grand art, mais l'absence de détestation est à coup sûr une preuve que ça n'en est pas
Tels sont les mots de Wit, le personnage le plus mystérieux de l'histoire, au cours d'une réflexion philosophique sur l'art placée opportunément à la toute fin de ce volume. Comme il le rappelle, il n'y a pas de grand art s'il ne suscite pas de grandes passions, s'il ne génère pas un certain niveau de haine. Or, c'est précisément cela le problème : au terme de ce livre, il n'y ni enthousiasme, ni rejet. Mais enfin, on en est tout de même venu à bout, de ces 1300 pages, et cela sans trop de peine, sans grand ennui. On n'en est même pas dégoûté, on veut encore en connaître la suite. C'est qu'au final Oathbringer, malgré ses carences, ne devait pas être si mauvais que cela.

Fil des commentaires
Adresse de rétrolien : https://balzac.fakeforreal.net/index.php/trackback/3045